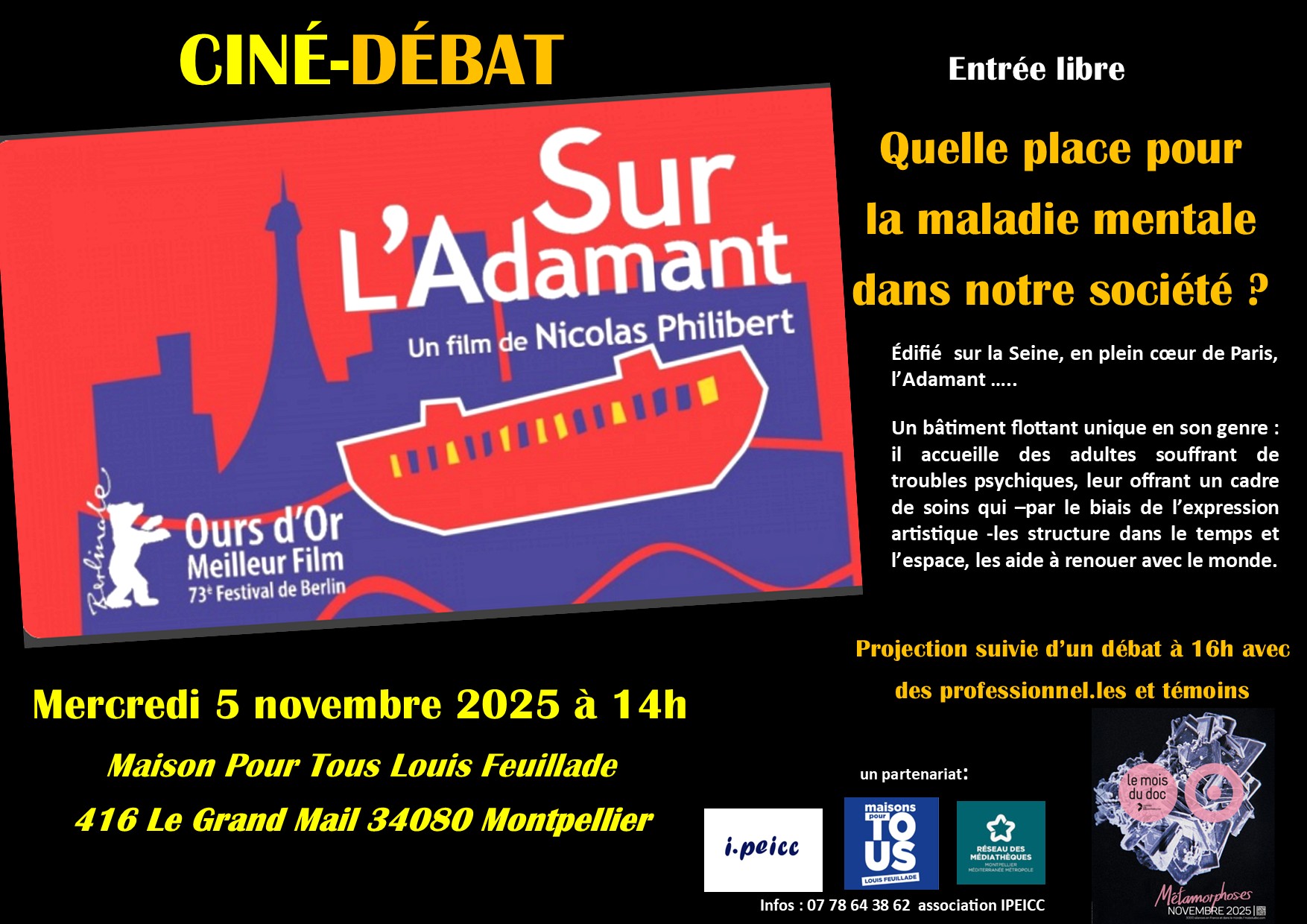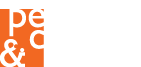Une exposition finale témoigne d’un parcours artistique et citoyen porté par i.PEICC à Montpellier une initiative soutenues par l'Association M28- Terres de Culture
Montpellier, octobre 2025 — Au terme de plusieurs mois d’exploration artistique, d’immersion culturelle et de rencontres humaines, les jeunes engagés dans le projet “Les chemins du vivant” ont présenté leur exposition finale dans les locaux d’i.PEICC, au cœur du quartier de la Mosson. Une restitution sensible, créative et puissante, qui a mis en lumière leur cheminement, mais aussi l’impact profond de ce projet de médiation culturelle porté par l’association i.PEICC, en partenariat avec les artistes, les festivals et les structures culturelles du territoire.
Une exposition à plusieurs voix
Cette exposition, conçue comme une installation immersive, mêlait photographies, vidéos, témoignages, bandes dessinées et films courts. Autant de supports qui ont permis de tracer les étapes du parcours des jeunes — de simples spectateurs curieux aux ambassadeurs actifs de la culture dans leur quartier.
Les visiteurs ont pu découvrir les visages et les voix des jeunes médiateurs : leurs récits de rencontres avec des artistes en résidence, leurs impressions face aux œuvres, leur réflexion sur le lien entre art, environnement et mémoire du territoire.
"Ce projet m’a permis de comprendre que la culture, ce n’est pas juste aller voir une pièce ou une expo. C’est un moyen de se connaître soi-même, et de parler de se qu’on vit ici, à la Paillade", confie Yassine, 17 ans, l’un des jeunes participants. "Voir des choses qui sont invisible au quotidien" commente Violetta, qui a participé à la rencontre des commisaires de l'exposition "Superbemarché" au MIAM dans la ville de Sète.
Un espace vidéo diffusait un film-documentaire, réalisé par les jeunes et Morgann leur animatrice, retraçant leurs visites, leurs échanges avec les artistes, et leur propre cheminement créatif et permettait également aux visiteurs d’écouter les coulisses du projet, à travers les voix des jeunes, des artistes, et de l’équipe d’i.PEICC.
Une approche d’éducation populaire au cœur du projet
Ce projet de médiation trouve sa force dans l’approche d’éducation populaire défendue par i.PEICC depuis plus de 30 ans. Loin de considérer les jeunes comme de simples “bénéficiaires”, le projet leur a permis de devenir acteurs de leur propre transformation, en développant leur esprit critique, leur autonomie, leur capacité à s’exprimer et à prendre des responsabilités.
"L’éducation populaire, ce n’est pas transmettre un savoir vertical. C’est créer un espace où chacun peut apprendre de l’autre, expérimenter, se tromper, et construire quelque chose collectivement. Et c’est ce qu’on a fait ici, avec ces jeunes", explique un intervenant à Peuple Culture.
Les deux circuits proposés – l’un autour de la réhabilitation des rivières et l’autre autour du patrimoine et de la transformation urbaine – ont permis d’ancrer la démarche dans des enjeux très concrets pour les jeunes, en lien avec leur cadre de vie et les mutations de leur quartier.
Une mosaïque de rencontres et de récits
Avec "Les chemins du vivant", i.PEICC a une fois encore démontré qu’une autre manière de faire culture est possible : inclusive, participative, ancrée dans les territoires, et portée par celles et ceux qui en sont habituellement éloignés.
L’exposition finale, bien plus qu’une simple restitution, a été vécue comme un moment de reconnaissance, un espace de visibilité pour une jeunesse souvent invisibilisée, mais pourtant pleine de créativité, de lucidité, et de désir d’agir.
M28 a fait le choix d'intégrer une structure dédiée à la Jeunesse dans son projet, motivant par la suite la mise en lien avec les différentes structures qui portent le projet et ipeicc. Pour nos jeunes cette initiative est porteuse de sens, au-delà des fragments de bonheurs qui ont émaillé ces rencontres, c'est un ancrage dans un territoire plus vaste que notre quartier aussi vivant soit-il pour les jeunes, un champ du possible désormais vu comme une terre de culture





(1)_large.jpg)









 "Bonjour,
"Bonjour,